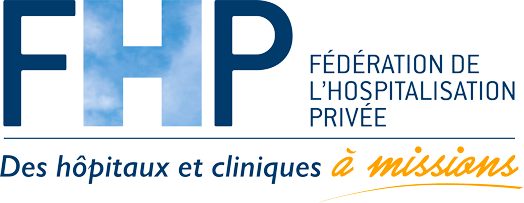Je pensais, avec une naïveté coupable sans doute, que les politiques publiques devaient être des vecteurs essentiels de transformation et de modernisation, sur des enjeux de long terme et dans un esprit de co-construction reconnaissant les acteurs d’un secteur comme des contributeurs légitimes. Ceci, a fortiori dans une situation économique très difficile qui requiert l’effort, le consentement et la coopération de tous.
Force est de constater, et de regretter, que les politiques publiques en matière de santé se construisent aujourd’hui davantage « contre » que « pour » et « avec » leurs parties prenantes, dans un court-termisme enrayant la dynamique d’amélioration de l’état de santé des populations. La tonalité dominante est le dévoiement du terme « responsabilisation » au profit de la suspicion a priori : à l’égard des patients, avec notamment des mesures sur les ALD (affections longue durée) dont le bénéfice en termes de santé publique, et donc de coût à terme, laisse circonspect ; à l’égard des industriels et des complémentaires, auxquels la logique de rabot s’applique tour à tour ; à l’égard des médecins libéraux ; à l’égard des paramédicaux, particulièrement ceux du secteur privé, qui pâtissent d’une absence de reconnaissance ; et bien sûr à l’égard des établissements de santé, qu’une « année blanche » condamne pour 2026 à des tarifs négatifs insoutenables.
Face à un tel tableau, la solution la plus simple – et simpliste – consiste à désigner des boucs-émissaires, au premier rang desquels les Agences Régionales de Santé dont le « bashing » est devenu le nouveau sport national. Dans plusieurs rapports ou déclarations intempestives, elles sont, selon les versions, préfectoralisées, écartelées entre Région et Département, et in fine démantelées et vidées de leur substance. Suivre cette voie constituerait une réelle régression pour la santé et les territoires et ne rajouterait que de la complexité. Les ARS servent donc de victimes expiatoires à un pilotage général défaillant, et à une gouvernance s’illustrant par une absence de stratégie visible et évaluée en santé.
En attendant, les sujets d’efficience que pourtant l’écosystème de santé partage en choeur, et qui sont défendus par une flopée de rapports et d’acteurs, demeurent insuffisamment portés. Or, l’impératif d’économies et les efforts demandés à tous seront d’autant mieux compris qu’ils s’inscrivent dans une réforme systémique et stratégique du système de santé, fondée sur l’efficience, la qualité, la pertinence et l’évaluation du service rendu. C’est la pérennité de notre système de santé qui se joue et la réponse ne peut être que collective et structurelle.
Lamine Gharbi